Formulaire d'inscription
Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.
Il est 23 heures passées dans le quartier de 国贸 Guomao, à Pékin. Les tours de verre reflètent encore la lumière des écrans, comme si la ville refusait de dormir. Un jeune employé en costume quitte enfin son bureau. Il descend dans la rue, les épaules lourdes, la cravate desserrée. Devant lui, un livreur à vélo file dans la nuit, le sac isotherme bringuebalant, pressé de livrer une dernière commande. Plus loin, derrière la baie vitrée d’un café encore ouvert, un étudiant révise, casque sur les oreilles, penché sur ses manuels pour préparer l’examen qui décidera de son avenir.
Cette scène est banale en Chine. Elle dit pourtant beaucoup de la pression qui habite le quotidien de millions de jeunes : travailler plus, performer toujours, se battre pour suivre un rythme imposé par la société et l’économie.
Mais depuis quelques années, deux expressions reviennent sans cesse sur les réseaux sociaux, dans les conversations entre amis ou dans des confidences murmurées : « tǎng píng » (躺平, s’allonger à plat) et « bǎi làn » (摆烂, laisser pourrir).
Derrière ces mots, il y a plus qu’un effet de mode. Il y a une manière de réagir à un système qui semble exiger toujours plus sans jamais offrir assez en retour. Ce n’est pas seulement paresse ou résignation, mais parfois une forme de protestation nécessaire face à une compétition sans fin.
En Chine, un mot revient souvent lorsqu’on cherche à décrire le malaise des jeunes générations : nèi juǎn (内卷). Littéralement, « s’enrouler vers l’intérieur ». Dans le langage courant, il désigne cette compétition, ce sur-effort collectif qui n’apporte aucun gain réel.
On l’illustre parfois par une image simple : imaginez un stade plein à craquer. Un spectateur se lève pour mieux voir. Puis un deuxième, puis un troisième… Bientôt, tout le monde est debout.
Résultat ? Personne ne voit mieux, mais tout le monde est fatigué. Le nèi juǎn, c’est exactement cela : une course où l’on dépense toujours plus d’énergie, sans jamais obtenir plus de place ou de clarté.
Officiellement interdit, le fameux rythme 996 (travailler de 9h à 21h, six jours sur sept) continue de hanter les open spaces. Les entreprises ne l’imposent pas toujours explicitement, mais la pression est bien réelle. On parle de « volontariat forcé » (qiángzhì zìyuàn, 强制自愿) : chacun sait qu’il n’est pas obligé de rester tard… mais que partir trop tôt peut coûter une promotion, voire un poste. Dans bien des bureaux, éteindre son ordinateur à 18h reste suspect. La loyauté se mesure au temps passé, plus qu’au travail accompli.
Cette logique s’installe dès les bancs de l’école. Les lycéens qui préparent le Gao Kao – l’examen national d’entrée à l’université – vivent des journées cadencées du lever à l’aube jusqu’aux devoirs tard dans la nuit.
L’obsession de la performance ne s’arrête jamais, car aux yeux de beaucoup de parents, la vie suit un scénario précis. Réussir ses examens. Trouver un emploi stable et bien payé. Acheter un appartement – même au prix d’une dette écrasante, devenant parfois un fangnú (房奴), un « esclave du logement ». Se marier jeune, avoir un enfant, puis deux si possible.
Ce chemin semble immuable. S’écarter de cette ligne, c’est prendre le risque de décevoir sa famille, d’être vu comme un « raté » par les proches et les voisins. Dans les repas de Nouvel An, les questions reviennent comme une rengaine : « Et toi, quand te maries-tu ? » ; « Tu as acheté ton appartement ? » ; « Ton salaire, il est de combien ? »
À force, beaucoup de jeunes ont le sentiment d’être pris dans une cage invisible. Le gâteau de la réussite économique ne grossit plus au même rythme qu’avant. La croissance ralentit, les prix de l’immobilier explosent, les emplois prestigieux sont saturés. Travailler toujours plus dur ne garantit plus une vie meilleure.
Et c’est là, dans cet étau social, que naissent les réponses du « tǎng píng » et du « bǎi làn ».
Lire aussi : Gaokao : l’examen qui façonne l’avenir de la jeuness chinoise

Face à cette course sans fin, certains jeunes Chinois choisissent une réponse inattendue : s’allonger. C’est ainsi qu’en 2021, un simple post publié sur un forum en ligne a enflammé les réseaux. L’auteur y expliquait avoir quitté un emploi épuisant pour se contenter de petits boulots, réduire ses besoins. Moins d’argent, certes, mais plus de temps pour soi, plus de silence, plus de liberté.
躺平 (tǎng píng) signifie littéralement « s’allonger à plat » ou « s’allonger au calme ». Ce n’est pas de la paresse. C’est un choix presque stratégique : sortir volontairement de la compétition, baisser la tête pour laisser passer la tempête. Là où le système exige toujours plus, ceux qui « s’allongent » décident de se contenter de moins.
Mais dans un pays où l’énergie, l’ambition et la combativité sont depuis toujours érigées en valeurs cardinales, ce geste paraît presque inconcevable. En Chine, où le mot 奋斗 (fèndòu, « lutte, combat ») est presque un idéal national, cette posture surprend. Elle choque certains parents, qui y voient de la faiblesse. Mais pour beaucoup de jeunes, le tǎng píng n’est pas une fuite : c’est une façon de reprendre le contrôle sur sa vie, même si cela implique de renoncer aux standards imposés.
Ce geste moderne fait écho à de vieux échos de la culture chinoise.
Le taoïsme, d’abord, avec son principe de wu wei (无为) : ne pas forcer, laisser les choses suivre leur cours naturel. Pourquoi lutter contre un courant trop fort, si ce n’est pour s’y briser ?
Puis la figure des lettrés de la dynastie Tang ou Song qui, déçus par les intrigues de la cour impériale, choisissaient de se retirer dans la montagne, pour écrire des poèmes, boire du thé, cultiver un jardin.
Dans une certaine mesure, le tǎng píng est une réinvention contemporaine de ce retrait : moins choisi par conviction philosophique que par lassitude sociale, mais porteur de la même aspiration à la simplicité.

Si le tǎng píng peut se lire comme une respiration, un retrait volontaire pour protéger son équilibre, le bǎi làn (摆烂) a une couleur plus sombre. Le terme vient du sport : quand un match est perdu d’avance, inutile de lutter, autant « laisser pourrir ». Dans le langage des jeunes Chinois, il désigne une résignation : ne plus faire d’effort, parce que de toute façon, l’effort ne paiera pas.
Sur Weibo et Douyin, on croise souvent ce type de phrase :
« Puisque je vais échouer à l’examen, autant passer la soirée à regarder des séries. »
« Puisque je ne serai jamais promu, je vais faire le strict minimum au bureau. »
Ce cynisme n’est pas une simple paresse. C’est une manière de tourner en dérision un système jugé trop exigeant et trop injuste. Là où le tǎng píng dit « je choisis d’en sortir », le bǎi làn dit « je lâche, puisque ça ne changera rien ».
Ce qui frappe, c’est que le bǎi làn prend le contrepied de ce qui est traditionnellement valorisé : l’effort acharné, la discipline, la volonté de toujours avancer. Là où hier on faisait de son mieux, aujourd’hui certains assument de faire « exprès mal », ou de laisser les choses se détériorer. C’est presque une provocation silencieuse : si le système ne joue pas franc jeu, pourquoi jouer sérieusement avec lui ?
Derrière la désinvolture affichée, le bǎi làn révèle une fragilité. Là où le tǎng píng garde une certaine part de sagesse héritée du taoïsme, le bǎi làn parle d’une génération qui doute du sens même de l’effort. Et c’est précisément ce qui heurte la génération précédente.

Pour comprendre le malaise, il faut d’abord regarder la distance qui sépare parents et enfants.
Les aînés ont connu une époque où l’effort portait ses fruits : étudier avec acharnement, accepter les privations, travailler sans compter permettait de gravir les échelons et de transformer son destin. Le pays tout entier avançait, porté par une croissance à deux chiffres.
Les jeunes, eux, héritent d’un monde saturé. La croissance ralentit, les prix explosent, les inégalités se creusent. Travailler plus ne suffit plus. Ils voient bien que le modèle de leurs parents — celui du 吃苦 (chīkǔ), « endurer l’amertume » pour récolter plus tard —ne fonctionne plus avec la même évidence. Ce décalage crée une incompréhension douloureuse : les uns parlent de sacrifice, les autres répondent par ironie.
À cette fracture générationnelle s’ajoute un autre poids, plus universel encore : celui d’un parcours de vie tout tracé, où chacun est sommé de cocher les cases attendues. En Chine, réussir sa vie suit encore un scénario rigide :diplôme prestigieux, emploi stable, appartement acheté, mariage, enfants. Chaque étape est entourée d’attentes familiales et sociales, et s’en écarter expose au jugement.
Un jeune qui refuse d’entrer dans cette logique est vite perçu comme paresseux, ingrat, voire irresponsable.C’est pourquoi le choix du tǎng píng ou du bǎi làn est si difficile à assumer : il va à l’encontre du récit collectif, qui valorise la lutte et la réussite visibles.
Internet a ouvert une brèche. Sur Weibo, Zhihu, Douban, les jeunes trouvent un espace où leurs sentiments prennent forme, où des mots comme tǎng píng et bǎi làn deviennent des étendards. Les discussions anonymes offrent une respiration collective : « Je ne suis pas seul à ressentir ça. »
Ces expressions sont autant des codes générationnels que des postures sociales. Elles permettent d’exprimer, parfois avec humour, un malaise qu’on n’ose pas dire ouvertement dans la sphère familiale ou au bureau.
Sous l’apparente légèreté des slogans, c’est une angoisse plus profonde qui affleure. L’angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne jamais rattraper un idéal devenu inaccessible. Dans un pays qui, au cœur de sa tradition, porte l’idée d’harmonie et d’équilibre, l’anxiété est devenue l’une des marques de la jeunesse.

Le tǎng píng et le bǎi làn ne sont pas de simples modes passagères. Ce sont des miroirs tendus à une société où la compétition semble infinie et où la jeunesse cherche à inventer de nouvelles manières d’exister. Derrière derrière l’allongement volontaire ou la résignation, il y a une même question : comment redéfinir ce que signifie « réussir sa vie »?
Pour certains parents, ces attitudes restent incompréhensibles, voire condamnables. Mais peut-être sont-elles aussi un signal : celui qu’il est temps de penser différemment l’équilibre entre travail et vie personnelle, entre ambition et bien-être, entre réussite matérielle et sérénité intérieure.
Apprendre ces mots – tǎng píng, bǎi làn, nèi juǎn – ce n’est pas seulement enrichir son vocabulaire. C’est entrer dans l’intimité de la Chine contemporaine, sentir battre le cœur de sa jeunesse, comprendre ses silences et ses respirations. C’est exactement ce que nous croyons chez TopChinois : que la langue ne s’apprend pas dans le vide, mais au contact du monde qui la fait vivre.
Nos cours ne se limitent pas à enseigner des caractères et des règles de grammaire : ils plongent dans la Chine d’aujourd’hui, ses expressions, ses débats, ses émotions. Apprendre le chinois avec nous, c’est découvrir la langue à travers la vie réelle, telle qu’elle se dit et s’invente chaque jour.
Et peut-être, en apprenant ces mots, sentirez-vous vous aussi qu’ils ne sont pas seulement chinois. Ils résonnent bien au-delà des frontières : comme un rappel que, partout, nous cherchons un rythme qui nous ressemble, un souffle qui nous appartienne.
Si vous êtes intéressé par l´apprentissage du chinois, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour connaître notre cours de chinois 😉
Vous pourriez aussi apprécier ces articles :


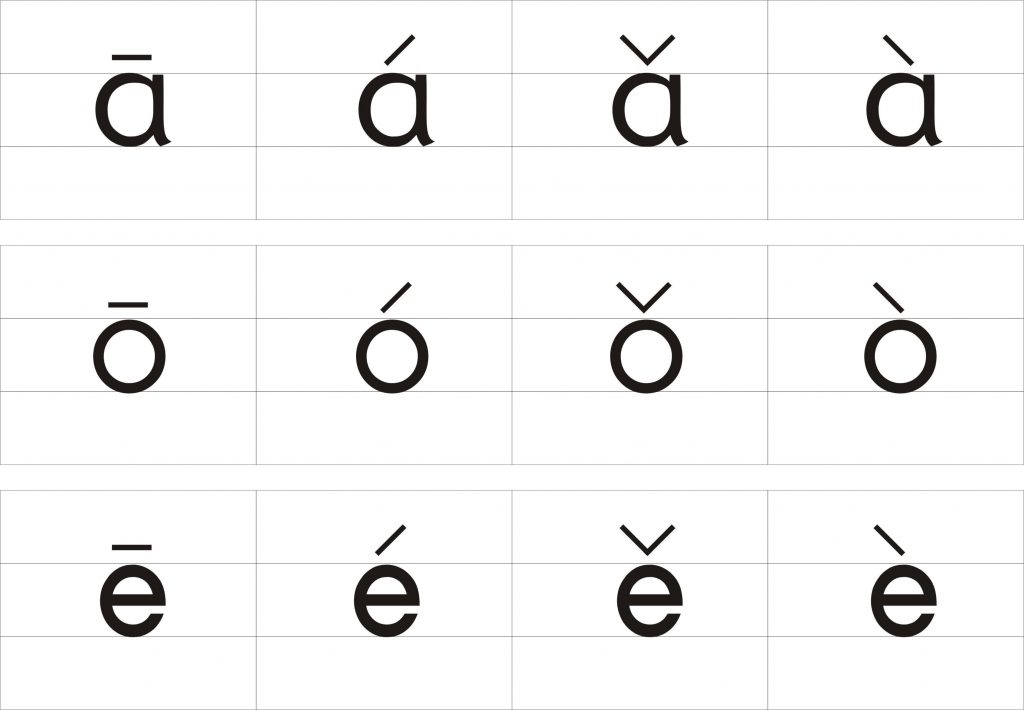



Merci beaucoup ! Nous avons bien reçu votre demande d’inscription, notre équipe reviendra vers vous. A très vite !
Grâce à vos indications, nous ferons de mon mieux pour vous aiguiller vers la formule la plus adaptée selon votre niveau, vos attentes ainsi que vos objectifs.

Laisser un commentaire